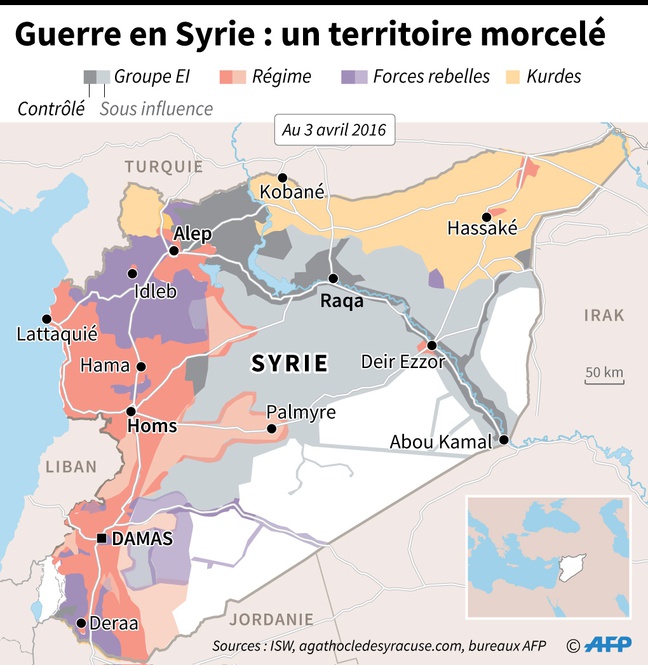« Regarde les animaux qui sont d’une taille exceptionnelle : le ciel les foudroie et ne les laisse pas jouir de leur supériorité ; mais les petits n’excitent point sa jalousie. Regarde les maisons les plus hautes, et les arbres aussi : sur eux descend la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. »*
Hérodote, Les histoires
Sur une carte, elle n’était guère qu’un bout de désert coincé entre la Jordanie et le golfe d’Aqaba séparant le royaume saoudien de son voisin égyptien. Il n’y avait rien à l’exception de kilomètres de sables s’étendant à perte de vues. Mais depuis 2017, ce néant a laissé place à un chantier gigantesque où des travailleurs venus d’Asie s’exténuent à créer de toutes pièces la nouvelle « cité du futur ». Car NEOM, c’est son nom, se veut la ville modèle pour l’avenir, à la fois moderne, connectée et robotisée.
Cette cité futuriste, c’est le grand projet de Mohamed Ben Salman (MBS), le prince héritier d’Arabie Saoudite et fils du roi Salman. Désireux de faire du royaume un champion du monde du numérique, MBS a lancé une transformation complète de la stratégie économique du pays, baptisée Vision 2030. NEOM est le symbole de cette révolution. Grandiose, gigantesque, hors-normes, la ville est à la mesure des ambitions du prince, sans limites. Et pourtant, malgré sa toute-puissance, MBS semble être tombé dans « l’hubris », ce penchant dont les grecs disaient qu’il est à l’origine de toutes les tragédies humaines. Comme Hérodote* l’avait d’ailleurs souligné, une trop grande ambition mène bien souvent à des catastrophes, le ciel rabattant « toujours ce qui dépasse la mesure ». En d’autres termes, à force de s’approcher trop près du soleil, MBS pourrait bien s’y brûler les ailes.
Il est évident que le prince héritier peut être perçue au premier chef comme une chance pour la monarchie. Âgé seulement de 32 ans, il offre ainsi un sérieux coup de rajeunissement pour un royaume rongé depuis des années par une gérontocratie grandissante des fils du roi fondateur Ibn Saoud. En même temps, MBS incarne le nécessaire changement de génération qui voit une jeunesse longtemps frustrée par ses aînés enfin accéder aux postes de responsabilité. Une fois devenu Roi, il sera de facto le premier souverain qui n’aura jamais connu l’homme qui a donné son nom au royaume. Etant lui-même ministre de la défense et conseiller économique spécial auprès de son père, le roi Salman, MBS s’est déjà attelé à nommer des jeunes technocrates à des postes clés faisant entrer massivement la jeune génération au sein de l’appareil d’Etat.
L’une des premières conséquences de ce changement fut que bien des tabous de la monarchie n’ont pas tardé à tomber tel un fuit mur. Sur le plan économique, premièrement, MBS et ses partisans remettent en cause la dépendance du pays au pétrole souhaitant à l’inverse spécialiser le royaume dans la production de biens et de services à haute technologie et à forte valeur ajoutée. Ce plan, Vision 2030, se paye d’ailleurs le luxe de porter atteinte à la sacro-sainte institution nationale qu’est la compagnie pétrolière Saudi Aramco dont une partie du capital a été privatisée en vue de financer un fond d’investissement public. Sur le plan religieux aussi, le prince héritier s’est montré enclin à desserrer un peu l’étau qui corsète la société autorisant notamment les femmes à conduire seules, immense révolution quand on connaît le rigorisme extrême du wahhabisme saoudien.
En réalité, Mohamed Ben Salman s’attaque de front aux trois piliers fondamentaux de la politique saoudienne, les intérêts pétroliers, le clergé wahhabite et la toute-puissance de l’ancienne génération, trois piliers dont le déclin commençait à se faire sentir depuis quelques années. Mais si on peut légitimement se féliciter de ces changements, la manière de les mettre en œuvre par le prince laisse craindre un affaiblissement durable de la monarchie.
Car le prince s’est imposé au détriment de ce qui fondait l’exceptionnelle stabilité de cette dernière. Celle-ci, subissant la menace permanente de périls intérieurs tels que l’instabilité des prix du pétrole, sa principale ressource ou bien encore le risque inhérent du radicalisme religieux, s’est toujours protégée aux moyens d’une répartition intelligente du pouvoir au sein de la famille Saoud entre les différentes tribus, toutes liées par mariage à la famille royale. Le pouvoir était ainsi collégial et représentatif d’un équilibre interne entre les factions, chacune étant associée au pouvoir en fonction de son importance. Le roi lui-même devait consulter au préalable les représentants des factions avant de prendre toute décision. Même la composition du gouvernement devait refléter cet équilibre.
Contrairement à une démocratie ou à une monarchie classique, la légitimité politique de la monarchie saoudienne auprès de sa population lui venait donc d’une affiliation tribale représentée au cœur même du pouvoir. Or, avec MBS tout cet équilibre qui avait si bien fonctionné est sur le point de rompre. Certes, il est exact de dire que l’identité tribale s’estompe chez les jeunes générations mais en nommant des technocrates à la place de membres de la famille royale, le prince héritier met de côté les leaders tribaux qui servaient d’intermédiaires nécessaires entre le peuple et ses dirigeants.
Pire, en ayant une administration à sa main, MBS supprime les contre-pouvoirs officieux qui régissaient la monarchie abandonnant de fait le principe de collégialité de la décision pour un mode autoritaire du pouvoir lié à sa personne. La monarchie saoudienne se transforme ainsi à l’image de son prince. Plus ambitieuse d’un côté, mais moins prudente et surtout moins rationnelle de l’autre, elle commet des fautes diplomatiques inhabituelles depuis l’ascension de MBS.
En novembre dernier, le prince a ainsi fait arrêter une grande partie de l’élite économique du pays pour ne pas avoir soutenu son plan Vision 2030 ce qui a conduit à une chute de l’investissement. Quelques jours plus tard, il poussa à la démission le premier ministre libanais Saad Hariri entraînant une rupture diplomatique entre les deux pays et une condamnation internationale sans appel contre la monarchie. Plus grave encore, furieux de voir le Qatar signer un accord gazier avec l’Iran, MBS a décidé de mettre en œuvre un blocus économique contre ce petit pays avec pour résultat de le pousser dans les bras des turques et des iraniens.
Comme nous pouvons le constater, bien qu’en voulant réformer, le prince héritier n’a fait qu’accroître les risques intérieurs en minant l’équilibre historique des pouvoirs et la légitimité populaire du régime tout en affaiblissant considérablement son pays sur la scène internationale. Son manque de patience et de recul diplomatique fait même peser un climat de tensions extrêmes avec l’Iran dont le conflit par procuration avec les rebelles houthistes au Yémen s’éternise depuis des mois. Hérodote avait raison. A force de pécher par Hubris, Mohamed Ben Salman et la monarchie s’exposent inévitablement à un probable retour de bâton.