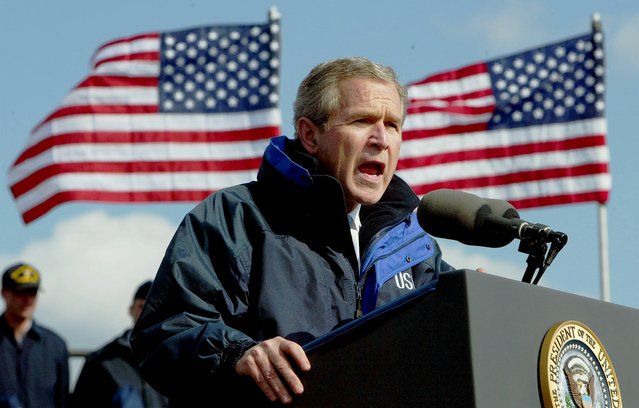Tout ça pour rien, serait-on tenté d’affirmer. Après des mois de batailles au sein de son parti pour finalement concocter le plan « Chequers » (du nom de la résidence d’été du premier ministre britannique), Theresa May s’est vue prier de revoir sa copie lors du sommet de Salzbourg du 20 Septembre dernier. Pour le président Français, ce projet était tout simplement « inacceptable » tandis que Donald Tusk, le président du conseil européen, avertissait les britanniques que leur plan « ne fonctionnera pas ». A Berlin, Angela Merkel estimait « qu’il y a beaucoup de travail à réaliser avant d’atteindre un accord ».
Et pourtant, la date butoir du 29 Mars prochain approche à grands pas si bien que l’on s’interroge sur la capacité des deux partis à trouver un motif d’entente. Il est clair, en effet, qu’il faudra des semaines, voire des mois, avant que Theresa May et son gouvernement ne parviennent à formaliser un nouveau plan susceptible de rallier l’ensemble des conservateurs. La tâche sera rendue d’autant plus difficile que la pression des décideurs économiques et financiers ne fera que monter en puissance à mesure que la perspective d’un non-accord sera de plus en plus probable.
Parviendra-t-on à un accord ? Et quels sont les obstacles qui mettent à mal les négociations ?
Pour l’instant, aucune raison de céder à la panique…
Depuis quelques semaines, les signaux d’alarmes se multiplient outre-Manche quant à la perspective d’un « no deal » aux effets catastrophiques. Dans les tabloïds, il n’y ainsi pas un jour qui passe sans son lot de nouvelles apocalyptiques supposées s’abattre sur la Grande Bretagne après la date limite du 29 Mars. De façon plus sérieuse, des hauts officiels britanniques tel le gouverneur de la banque centrale ou encore le président de la fédération patronale, ont eux aussi mis en garde contre les conséquences négatives d’une absence d’accord.
Mais pour l’heure, si ce scénario est envisagé, il n’est pas le plus probable et ce pour deux raisons fondamentales. D’une part, aucune des deux parties n’a intérêt à se quitter sans un accord, même si celui-ci se fait à minima. Côté anglais par exemple, près de 40% du commerce extérieur se réalise avec l’Union européenne. Un « No deal » entraînerait certainement une crise économique et financière, au moins à court terme. A cela, il faut ajouter le fait que l’essentiel des produits de consommation de la vie courante viennent d’Europe, sans compter qu’une rupture brutale impacterait de facto l’ensemble des accords commerciaux britanniques avec le monde. Il est dès lors probable que la Grande-Bretagne subira un chamboulement économique tel que le cabinet de Theresa May préférera rechercher « un Bad Deal » plutôt qu’un « No Deal ».
Côté européen, la perspective d’une rupture brutale est aussi envisagée avec angoisse. La France affiche ainsi un excédent commercial vis-à-vis de Londres de l’ordre de 12 Milliards d’euros et est engagée avec son partenaire britannique dans une coopération étroite en matières militaires et diplomatiques. L’Allemagne possède également un excédent commercial considérable qui risque de se dilapider à partir du 29 Mars tandis qu’énormément d’établissements financiers ont des liens privilégiés avec la City de Londres. Là aussi, comme pour les britanniques, les européens seront plus enclins au « Bad Deal » qu’au « No deal ».
La deuxième raison d’être optimiste est qu’il est fort probable que, plus la date limite approche, plus la peur d’un non-accord poussera les deux partis à trouver des accommodations auxquelles pour l’heure elles ne sont pas prêtes à souscrire. En d’autres termes, c’est le sentiment d’urgence qui généralement débloque les négociations. Aujourd’hui, paradoxalement, il est encore trop tôt pour voir Londres ou Bruxelles céder aux revendications de l’autre partie, chacun étant convaincu qu’il possède suffisamment de temps pour retourner le rapport de forces en sa faveur. En revanche, plus la « deadline » approchera, plus la volonté d’un compromis sera au rendez-vous.
…Mais quelques raisons de s’inquiéter tout de même
Aujourd’hui, les négociations du Brexit patinent du fait non pas des conditions commerciales et financières de la sortie du Royaume-Uni mais sur la question de la libre-circulation des personnes. Comme l’avait affirmé Michel Barnier, le négociateur de la commission européenne, les deux parties se sont en fait accordées sur au moins 80% des points de négociation. De la période transitoire de trois ans qui devrait suivre le Brexit à l’accord sur la facture budgétaire de 40 milliards d’euros que devra verser Londres, beaucoup a déjà été fait. Et pourtant, ces 80% disparaîtront si les parties ne trouvent pas un consensus sur les 20% restants car les parlements nationaux ne peuvent ratifier le traité que si celui-ci est complet.
De ce point de vue, la négociation ne concerne vraiment que l’épineuse question de la liberté de circulation des personnes. Pour les européens, en effet, la Grande Bretagne ne peut accéder au marché unique que si les quatre libertés fondamentales suivantes sont respectées : libre circulation de l’information, des marchandises, des capitaux et des hommes. Sur cette dernière, Londres refuse catégoriquement de céder. Pour Theresa May, il est évident que l’origine même du Brexit se trouve dans la profonde angoisse migratoire du peuple britannique, alimentée notamment par l’arrivée d’un million de travailleurs venus des pays d’Europe de l’Est dans les années 2000. Céder sur ce point serait pour elle une trahison du vote des électeurs lors du référendum, trahison qui serait, de plus, un véritable boulet électoral pour le parti conservateur dans les années qui viennent.
A l’inverse, les européens restent fermes sur le principe de la liberté de mouvement. Ils refusent en effet ce qu’ils appellent « un marché unique à la carte » qui pourrait donner des idées à d’autres pays européens. Et de fait, si l’Europe répond favorablement aux exigences britanniques, ces derniers auraient tous les avantages du marché unique sans l’inconvénient migratoire, ce qui laisserait à coup sûr la porte ouverte à d’autres Etats européens pour demander un traitement similaire. Autant dire que l’Union Européenne ne peut se permettre d’être accommodante.
Dans ce cadre, la question nord-irlandaise prend une importance fondamentale. Les accords du Vendredi Saint, signés en 1998 et qui ont mis fin au conflit entre protestants et catholiques, prévoyaient en effet la libre-circulation des personnes entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Or, en refusant la liberté de circulation, le gouvernement britannique se place en rupture avec ces accords alors que l’Union Européenne, elle-même, supervise leurs mises en œuvre. Cette position dogmatique, Theresa May la doit à son erreur politique d’avoir dissous le parlement, pourtant majoritairement conservateur, en juin 2017. Dorénavant, elle ne peut gouverner qu’au prix d’une alliance avec les unionistes irlandais qui refusent de céder sur la question des frontières entre les deux Irlandes. Il est donc impossible pour Theresa May de répondre aux attentes européennes sous peine de voir son gouvernement être renversé, ce qui entraînerait de nouvelles élections périlleuses pour les conservateurs.
Comme nous pouvons le constater, la question de la libre-circulation des personnes est l’obstacle principal à un accord. Les deux parties semblent n’avoir que très peu de marges de manœuvres et surtout rien pour l’heure ne montre un quelconque progrès dans ces négociations. Pourtant, aux vues des intérêts économiques et financiers des deux côtés de la Manche, il me parait encore peu probable qu’au soir du 29 Mars les relations soient rompues sans un agrément. A la fin, Européens et Britanniques préféreront toujours un « Bad Deal » plutôt qu’un « No deal ».