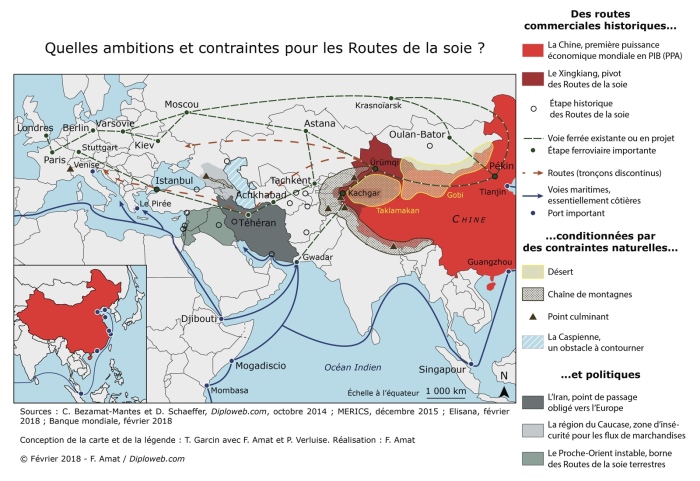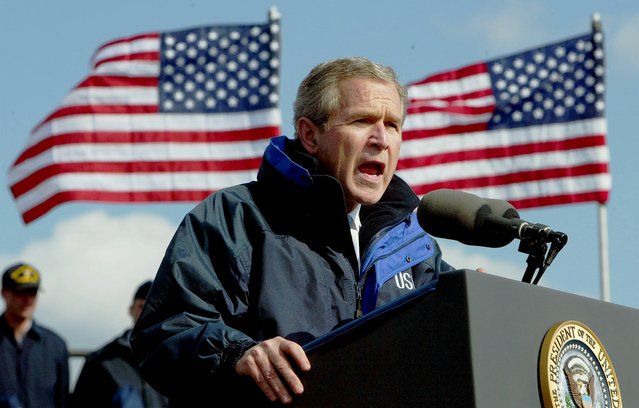La Chine va-t-elle supprimer ses approvisionnements en terres rares ? Cette question était sur toutes les lèvres le mois dernier lorsque Pékin avait annoncé son intention de ne plus exporter ces matériaux critiques que l’on retrouve dans nos portables et nos ordinateurs. Réagissant à la décision prise par l’administration Trump d’interdire aux entreprises américaines de commercer avec Huawei, l’empire du milieu espérait ainsi montrer qu’il tenait l’économie mondiale entre ses mains et que sans lui la production d’objets électroniques était tout simplement impossible.
Relayant cette menace, les médias du monde entier se sont inquiétés devant le risque d’une rupture brutale d’approvisionnement de ces terres rares. Il est vrai qu’en produisant près de 70% de ces métaux précieux, Pékin semblait pouvoir mettre ses menaces à exécution. Mais, en réalité, cette vision globale d’un marché des terres rares dominé par la Chine ne tient pas la route. En d’autres termes, le levier stratégique des terres rares est dans les faits beaucoup moins important pour le pouvoir chinois que ne le laisse penser une approche trop rapide et superficielle du marché.
Comment expliquer ce paradoxe qui veut que, même en contrôlant 70% de la production, Pékin ne soit pas en mesure d’utiliser les terres rares comme une arme dans sa politique commerciale ? Pour le dire autrement pourquoi la Chine ne peut jouer la carte de la guerre des métaux rares ?
Métaux et terres rares : une distinction capitale
Tout d’abord, il convient de distinguer entre les terres rares et les métaux rares. Les premières, contrairement à leurs noms, sont relativement abondantes dans le monde. On y trouve du zinc, de l’aluminium mais aussi des métaux plus méconnus tels que le dysprosium, utilisé dans les moteurs hybrides, et le cérium, présent dans les pots catalytiques. Les métaux rares sont quant eux en nombre très limité car ils possèdent des propriétés exceptionnelles et sont donc très chers à l’achat. On trouve dans cette catégorie des minerais telles que le cobalt ou le niobium, matériaux indispensables par exemple à la production de voitures électriques. On estime d’ailleurs que ces dernières contiennent entre 9 et 11 kg de minerais (terres et métaux) rares, soit deux fois plus que dans une voiture à essence.
Cette distinction entre terres et métaux est fondamentale car elle change complètement la perspective du quasi-monopole chinois. En effet, lorsque l’on dit que Pékin contrôle 70% de la production de minerais rares, on ne fait pas la décomposition entre les métaux, qui sont limités et les terres rares, qui sont abondantes. Par exemple, on estime que le pays ne posséderait en réalité que 40% des réserves de terres rares ce qui lui donne un certain pouvoir de marché mais en aucun cas le contrôle absolu sur ces matières premières. De même, certains métaux rares ne sont pas fabriqués par la Chine comme le Béryllium, produit à 90% par les Etats-Unis, ou le niobium dont le Brésil s’arroge 90% de la production.
Par conséquent, la Chine est nettement moins bien positionnée en termes de réserves de minerais rares que ne le laisse penser le chiffre brut de 70% de contrôle de la production. D’une part, l’essentiel des réserves chinoises sont des terres rares dont la caractéristique est d’être relativement abondante dans le monde ce qui signifie que des alternatives existent en cas d’embargo imposé par Pékin. D’autre part, certains métaux rares n’étant pas disponibles dans le pays, le gouvernement chinois aura du mal à utiliser l’arme des minerais rares sans subir en représailles un embargo du même type sur les métaux qu’elle ne possède pas. En d’autres termes, Pékin risque un sévère retour de bâton si elle joue la carte des terres rares.
La transformation du modèle de production chinois de terres et métaux rares
La Chine est d’autant moins en position de force qu’elle a transformé en profondeur son secteur minier ces dernières années. Ainsi, pour simplifier, la chaîne de valeur de la production des terres rares se compose grosso modo de 5 étapes : l’extraction, le traitement du minerai, la transformation métallique, la fabrication en produits et le recyclage. Pendant longtemps, jusqu’au début des années 2010, l’empire du milieu s’était spécialisé sur l’ensemble de la chaîne, passant de l’activité extractive (Upstream) au raffinage (downstream) dans une intégration complète de la filière. Pékin était d’autant plus disposée à adopter ce modèle de production qu’aucun autre pays ne souhaitait assumer le coût environnemental gigantesque de l’extraction et de la transformation des terres rares.
Ainsi, ces matériaux posent un problème écologique non seulement en termes de déchets mais aussi par l’utilisation intensive de produits chimiques qui combinés avec de l’eau viennent polluer directement les rivières et les nappes phréatiques. Pourtant, depuis l’instauration du XIIIème plan quinquennal en 2015, le pouvoir chinois prône l’édification d’une « civilisation écologique » entraînant avec elle la fermeture de nombreuses mines de terres rares. En réalité, Pékin a fait le choix de se spécialiser dans l’activité de transformation de la filière, abandonnant l’activité la plus pollueuse, l’extraction, au profit du segment à plus haute valeur ajoutée et à plus faible coût écologique. La chine a ainsi largement sous-traité l’activité extractive à des pays comme l’Indonésie ou l’Australie.
Ce changement de modèle explique d’ailleurs pourquoi la part de la production chinoise a chuté de 95% en 2010 à 70% aujourd’hui. Le pays devient de manière croissante non pas un producteur de terres rares mais un transformateur de ces minerais. La nuance est importante car elle rend la Chine de plus en plus dépendante des importations de terres et métaux rares si bien qu’en mars de cette année le pays est devenu le premier importateur au monde de ces matériaux stratégiques. On estime par ailleurs que les chinois seront importateurs nets d’ici à 2025.
Et la tendance ne risque pas de s’inverser. La montée en puissance des capacités technologiques du pays à la suite du plan « Made in China 2025 » et son virage vers la transition énergétique entraînent en effet une demande croissante de ces métaux qui à termes dépassera largement les capacités de production chinoises. De même, étant donné que les industries chinoises sont encore tributaires des composants réexpédiés en Chine par des utilisateurs de terres rares d’autres pays, ne plus fournir ces pays revient à agir contre ses propres intérêts industriels.
Par conséquent, un embargo sur les terres rares chinoises serait doublement contre-productif. D’un côté, cette mesure mettrait en difficulté toute la filière downstream que Pékin souhaite pourtant développer. D’un autre côté, elle entraînerait une surenchère des prix à un moment où la production domestique ne suffit plus à alimenter la demande chinoise.
La Chine n’a donc aucun intérêt à jouer la carte de l’embargo sur ses ressources en terres rares. Ne possédant que 40% des réserves et étant devenue le premier importateur au monde de ces ressources, elle ne peut en effet mettre cette menace à exécution sans subir elle-même les conséquences de cette stratégie. Pour le dire autrement, Pékin se tirerait toute seule une balle dans le pied si elle venait à choisir cette voie. Il me paraît dès lors peu probable de voir le pouvoir chinois s’engager dans une dangereuse guerre des métaux rares.