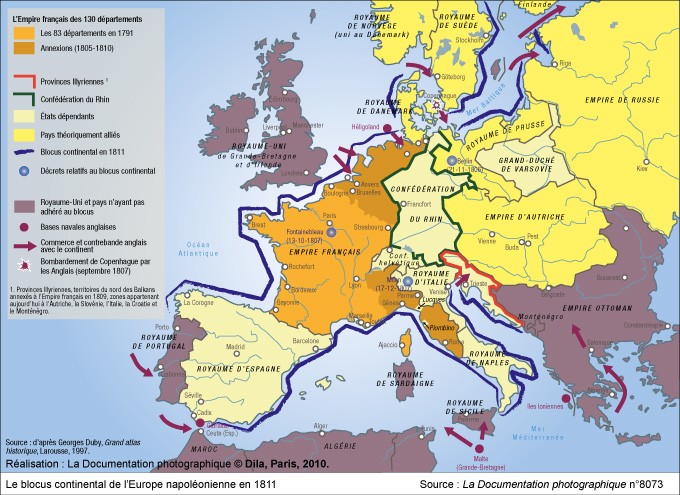Fascisme et communisme. Voici deux idéologies dont le XXème siècle a prouvé la dangerosité. Toutes les deux ont en commun un goût délibéré pour la violence et partagent la fabuleuse ambition de « transformer l’homme ». Bien que le Fascisme soit associé de nos jours au Mal absolu, il ne faut pas oublier que le Communisme est coupable d’un nombre encore plus important de morts. C’est que le premier assumait parfaitement sa violence tandis que le second s’est toujours drapé dans le mythe de la société idéale et de l’utopie.
Mais pourquoi une histoire du fascisme et du communisme ? L’objectif de cette série d’articles est d’étudier à la fois les ressorts de ces idéologies mais également les causes qui les ont rendues possibles. De la sorte, nous verrons les différences mais aussi les points communs entre le Fascisme et le communisme. Car toutes les deux naissent sur le même terreau : la modernité.
Comme l’avait montré Hannah Arendt, ces régimes politiques n’avaient en effet jamais existé auparavant. Malgré l’Inquisition espagnole, la Monarchie absolue ou le « Despotisme éclairé », il eût été impossible dans la période pré-moderne de concevoir une organisation totalitaire contrôlant la totalité des mouvements humains. Il existe donc quelque chose de singulier dans la modernité qui rend possible et concevable « l’Etat total » (1).
Dans ce premier article, je m’attarderai donc sur les caractéristiques de cette modernité dont les idéologies fascistes et communistes se promettaient d’en dépasser les contradictions. Pour atteindre cet objectif, je prendrai donc le point de vue de trois penseurs de la modernité : Benjamin Constant, Tocqueville et Louis Dumont. Avec ces trois auteurs, je tenterai de percer le mystère de la modernité.

Benjamin Constant : la liberté des modernes
Benjamin Constant fut toute sa vie un intellectuel engagé. Journaliste, il défendit la Révolution française contre Burke puis apporta son soutient au 18 Brumaire de Bonaparte. En 1814, il fut l’un des premiers à demander le retour de Louis XVIII même s’il exigea en retour une charte constitutionnelle beaucoup plus libérale que celle proposée par Talleyrand à Compiègne. Lors des Cent-jours, il s’allia avec Napoléon, toujours dans le but d’obtenir une constitution libérale. Après Waterloo, il fut contraint à l’exil en Angleterre. Il ne retourna en France qu’en 1819. Son dernier fait d’arme fut de soutenir la Révolution de 1830 et la prise de pouvoir de Louis-Philippe.
De cette description brève de la vie du personnage, on peut s’apercevoir que Constant fut un défenseur acharné du Libéralisme s’opposant d’un même trait à la Contre-révolution d’un Joseph de Maistre et à la terreur jacobine de Robespierre et de Saint-Just. Ce qui est intéressant chez cet auteur, c’est qu’il fut au cœur de la Révolution Française, à savoir cet acte par lequel la France entre dans la modernité. Il s’aperçoit donc de la transformation de la société mais aussi des contradictions qui n’ont pas manqué apparaître.
De la politique du Comité de Salut Public, par exemple, il explique que son erreur fut de croire qu’il était possible de refaire de la France une « Polis » athénienne de la même manière que Rousseau envisageait le Contrat Social. Pour Constant, l’homme moderne n’est plus ce citoyen du temps d’Aristote dont la suprême liberté était dans « la participation active et constante au pouvoir collectif ». Au contraire, la liberté des modernes est « dans la jouissance paisible de l’indépendance privée » (2). L’originalité de la modernité est donc de séparer la sphère de « la liberté civile » avec celle de « l’intérêt public » de sorte que l’individu doit se séparer de ses communautés d’appartenance s’il souhaite être libre.

Or cette liberté, dite d’indifférenciation, engendre des problèmes politiques considérables. Tout d’abord, elle modifie en profondeur la teneur du lien social. Dans les sociétés pré-modernes, en effet, l’appartenance à une communauté se faisait tout à fait naturellement ce qui impliquait des droits et des devoirs inaliénables de fait. A l’inverse, les sociétés modernes sont composées d’individus dont l’appartenance à une communauté est subordonnée par « l’intérêt privé ».
Dès lors, cette organisation communautaire est par nature friable, soumise constamment au bon vouloir des individus et menacée presque à chaque instant de disparaître. La Nation, nous dit Constant, bien qu’elle semble triompher avec la Révolution est en fait menacée dans son être d’une désagrégation inévitable. Or, ce sera contre cette dissolution sociale et pour un retour à la forme communautaire de la liberté que le Communisme et le Fascisme se proposeront de transformer l’homme.
De plus, en souhaitant émanciper l’individu de toutes obligations communautaires, la liberté des modernes pose la question du bien commun. Ce terme rendu célèbre par Saint-Thomas d’Aquin visait à séparer « l’intérêt individuel » de « l’intérêt de la collectivité ». Dans la Grèce antique ou au Moyen-Age, il y avait donc un objectif supérieur aux hommes, capable de transcender leurs existences individuelles. Avec la modernité, cette idée de « bien commun » s’est volatilisée. L’homme ne recherche plus que son propre intérêt ce qui induit qu’il le cherche parfois au détriment des autres hommes. La société n’est plus dès lors qu’un vaste champ d’affrontement des « intérêts individuels » qui se concurrencent les uns des autres. De fait, le terme de « socialisme », fondé par Pierre Leroux (en image ci-dessous) en 1834, visait justement à envisager une société qui rétablirait le « bien commun » et la solidarité entre ces membres.

Le jeune Engels, lui-même, avant d’être contaminé par le matérialisme scientifique de Marx, prenait appui sur ce « bien commun » de d’Aquin pour établir une société communiste. Au fond, la critique des socialistes du XIXème siècle, Marx, Engels, Leroux, Louis Blanc ou encore Bakounine, visait particulièrement la nature individualiste de l’homme moderne et surtout son incapacité à envisager de s’inscrire dans un cadre communautaire et solidaire. Marx décrivait d’ailleurs la modernité comme une société composée de « Robinson Crusoé » (il utilise le terme de « Robinsonnades »), indifférents aux autres et totalement isolés du reste de leurs semblables.
Constant fut donc l’un des premiers à remarquer l’originalité de la modernité vis-à-vis des périodes qui la précèdent. L’homme n’est plus déterminé par une appartenance à une communauté donnée mais par une liberté émancipatrice de toutes les obligations liées aux liens communautaires. Il n’y a donc plus de citoyens comme aux temps de Platon, qui faisaient du « bien commun » l’objectif le plus gratifiant de toute existence individuelle, ni même de membres de communauté comme au moyen-âge, mais un homme par nature indéterminé, poursuivant seul son « intérêt privé ».
De cette situation, Constant (en image ci-dessous) en fait l’apologie mais il oublie les graves problèmes politiques qui lui sont liée. Avec des individus libres de poursuivre leurs seuls intérêts, comment maintenir debout une société ? Comment replacer le bien commun au cœur des préoccupations des hommes ? A toutes ces questions, le Fascisme et le Communisme proposent des réponses, chacune de ces idéologies s’efforçant de retrouver l’unité perdue des anciennes communautés. C’est d’ailleurs pourquoi elles ne pouvaient exister avant la modernité étant donné que l’appartenance à une communauté était pour l’homme une donnée inhérente à son existence.

Tocqueville : conditions de l’individu démocratique
Alexis de Tocqueville fut comme Benjamin Constant un écrivain engagé en politique. Élu député sous la Monarchie de Juillet, il fut en 1848 l’un des artisans de la constitution de la IIème République. Opposant à Napoléon III, il fut déchu de tout mandat politique sous le second Empire. C’est d’ailleurs dans cette période difficile qu’il écrira son dernier ouvrage, le plus important pour lui, l’Ancien Régime et la Révolution.
Pour comprendre la pensée de Tocqueville, il est nécessaire de se replacer dans la vie de l’auteur. Car dès le début, ce jeune aristocrate normand, s’est intéressé aux originalités de la modernité. Parti en Amérique, il y a trouvé non pas le passé de l’Europe mais son avenir. « J’avoue que dans l’Amérique j’ai vu plus que l’Amérique, j’y ai cherché l’image de la démocratie elle-même. » (3) Pour lui, la modernité se caractérise par la « démocratie », c’est-à-dire un esprit fait de liberté individuelle et d’égalité des conditions.
En termes de liberté, il est très proche de Constant même s’il conçoit l’immense problème politique et social que pose l’individualisme. « Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains ; elle le ramène sans cesse vers lui seul et menace de la renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. » De ce repli sur la sphère privée, à savoir la sphère non-politique, Hannah Arendt (en image) en tirera son concept central « d’atomisation des masses » qui explique selon elle la facilité de la domination totalitaire (4).

Tocqueville ajoute néanmoins deux éléments supplémentaires que Constant n’avait pas vu. Le premier point concerne l’égalité des conditions. Pour Tocqueville, l’histoire conduit inévitablement les hommes à égaliser leurs conditions. « Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux Etats-Unis, ont attiré mon attention, aucun n’a plus vivement frappé mes regards que l’égalité des conditions. Je découvris sans peine l’influence prodigieuse qu’exerce ce premier fait sur la marche de la société ; il donne à l’esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois ; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés. »
Ce que Tocqueville tient à montrer, c’est l’extraordinaire attachement des sociétés modernes à l’égalité de sorte que l’homme moderne préfère cette égalité à sa liberté. Or, au moment même où Tocqueville écrit son De la démocratie en Amérique, l’inégalité des richesses s’est substituée aux anciennes inégalités de naissance. De fait, loin d’avoir aboli l’inégalité, la modernité crée une nouvelle forme d’inégalité, plus intolérable que les autres, car l’homme moderne est traversé de passions égalitaires. Bien que Tocqueville ne soit pas marxiste, on peut voir dans cette « passion pour l’égalité » un des fondements de la pensée communiste. Le communisme se propose, en effet, de dépasser cette contradiction de la modernité aux moyens d’une utopie égalitaire.
Le deuxième apport de Tocqueville consiste dans son analyse historique à voir précisément ce qui différencie l’Europe des Etats-Unis. Car, contrairement à sa première analyse, l’auteur voit dans la Révolution française une entrée différente des français dans la modernité par rapport aux anglais, et surtout aux américains. En France, contrairement aux pays anglo-saxons, la modernité, ce qu’il nomme « la Démocratie », s’effectue contre un « Ancien régime », inconnu des anglais et des américains. Il y a donc selon Tocqueville une illusion des révolutionnaires français qui est de croire que l’individu démocratique naît de la Révolution alors qu’il est le fruit d’une longue sédimentation historique. C’est tout l’objet de l’Ancien Régime et la Révolution.
Or, cette vision tocquevillienne aura des conséquences que Tocqueville n’aurait jamais pu imaginer. En effet, l’illusion révolutionnaire jouera un rôle primordial dans la constitution des totalitarismes au XXème siècle. C’est de cette illusion, par exemple, que provient la théorie révolutionnaire d’un Marx ou d’un Lénine comme si au fond la Révolution française avait fait croire aux hommes que la Révolution était l’unique moyen pour résoudre les contradictions de la modernité. A travers la Révolution, c’est d’ailleurs la toute-puissance du Politique qui sera mise au service des idéologies communistes et fascistes.
On peut également dire que parce qu’il n’y a pas eu de Révolution aux Etats-Unis, et donc pas « d’Ancien Régime », les américains ont été immunisés très tôt par les tentations totalitaires, la Révolution n’ayant pour eux guère plus de sens que le Socialisme.
Tocqueville (en image) fut donc un penseur primordial de la modernité. Cette dernière, en plus de façonner un homme indépendant et isolé de ses semblables, proie facile plus tard pour tous les totalitarismes, crée chez l’homme une irrésistible « passion égalitaire » rendant insupportable l’extraordinaire inégalité des richesses engendrée par le capitalisme sauvage du XIXème siècle. A cette contradiction, s’ajoute une profonde illusion en Europe sur la puissance révolutionnaire de modifier radicalement le cours des choses, illusion qui conduit les modernes à privilégier l’action violente plutôt que les réformes.

Louis Dumont et la société de marché
Sociologue de formation, Louis Dumont n’a pas connu comme Constant et Tocqueville les frissons de l’engagement politique. Il se fait connaître par ses travaux sur la société indienne, travaux qui l’ont sensibilisé sur les questions centrales de l’individualisme et de l’holisme. C’est ainsi en Inde que Dumont a pu se rendre compte des effets déstabilisateurs de la modernité sur les structures sociales.
Il fut en fait grandement inspiré par l’œuvre fondatrice de Karl Polanyi, La grande Transformation, publiée en 1944. Pour Dumont, la société moderne se différencie de toutes les autres par « la séparation radicale des aspects économiques du tissu social et leur construction en un domaine autonome » (5). En d’autres termes, la modernité, contrairement aux périodes précédentes, est traversée par une rupture anthropologique fondamentale faisant des sociétés humaines des « sociétés de marché ». C’est ce que Polanyi (en image)nomme le « désencastrement de l’économie ».

Dans les sociétés pré-modernes, l’économie existe mais en tant que subordonnée à la totalité sociale de sorte qu’elle n’est qu’un rouage, d’ailleurs peu important, de l’ordre collectif. A l’inverse, dans les sociétés modernes, l’économie prend une place démesurée dans les consciences individuelles. C’est que loin d’être une simple sphère d’existence de la vie humaine, l’économie fait figure aujourd’hui de totalité de l’ordre social.
Le tournant se déroule en Angleterre au moment de la Révolution industrielle au XVIIIème siècle puis s’exporte dans le reste de l’Europe au XIXème. Selon Polanyi, la « société de marché » prend forme dès lors que la terre, la monnaie et le travail sont marchandisés, c’est-à-dire dès lors que ces trois institutions font l’objet d’une confrontation entre une offre et une demande. Marx avait vu pareillement que le « Capitalisme » prend naissance au moment où les propriétaires fonciers anglais privatisent leurs terres grâce aux « enclosures ». Se développe dès lors une sphère autonome où interagissent des offreurs et des consommateurs : le marché.
Ce point est capital et rejoint la définition que donne Constant sur « la liberté des modernes » car le marché devient le lieu théorique où s’exprime ce type de liberté. Ainsi, les modernes inscrivent leur « jouissance paisible de l’indépendance privée » au sein de cette sphère économique. Bien entendu, ce domaine économique doit le plus possible échapper à l’emprise du Politique si l’on souhaite s’assurer que la liberté individuelle de chacun soit respectée. On retrouve là l’origine de la pensée libérale. L’économie n’est en fait que le domaine de satisfaction des intérêts privés, personnelles, tandis que le Politique, lui, poursuit un objectif collectif. On pourrait ainsi dire que l’économique représente la tyrannie de l’individu vis-à-vis du collectif et que la Politique, à l’inverse, représente la tyrannie du collectif sur l’individu.
Dumont (en image ci-dessous) exprime quand même une vive inquiétude quant à l’avenir de ces « sociétés de marché ». En effet, si l’économie est la sphère des intérêts individuels, sur quelles bases construire le lien social ? En d’autres termes, le marché peut-il faire office de société ? Sur cette question, les fascistes et les communistes répondent clairement non, les libéraux oui mais. Oui mais car si pour certains libéraux comme Hayek le marché est un « ordre spontané », d’autres comme Adam Smith (6) où Montesquieu pensent que le Marché ne peut fonctionner sans une réalité anthropologique qui lui est extérieure et qui lui assure une base indispensable pour faire société, la sympathie pour Smith, les mœurs pour Montesquieu.

En cela, le marché et la modernité agissent selon le terme de Péguy en « parasite » (7) ne vivant que sur des réalités pré-modernes qu’elle contribue à détruire. C’est dans ce sens que prennent appui les fascistes et les communistes pour envisager un nouvel ordre social. Pour eux, il est nécessaire de replacer la primauté du collectif sur l’individu et de revenir sur la séparation de l’économique d’avec le politique. Cela passera chez Marx par la réappropriation collective des moyens de production tandis que chez Hitler cela passera par la soumission totale de l’individu aux impératifs de la communauté raciale.
Dumont nous offre donc une image d’une modernité dans laquelle les individus ne tissent des liens sociaux qu’à travers l’entremise du Marché. L’homme moderne est ainsi par nature individualiste pris dans le sens qu’il place la satisfaction de ces intérêts personnels avant toute considération collective. Contrairement aux sociétés holistes, la société moderne met en œuvre la primauté de l’économique sur le politique de sorte que toute notion de « bien commun » est laissée à l’abandon.
Constant, Tocqueville, Dumont, de ces trois auteurs, nous avons pu voir en quoi la modernité est une époque complètement différente des autres. Contrairement au citoyen athénien ou au paysan des campagnes du Moyen-âge, pour qui ni l’appartenance à une communauté ni la soumission aux impératifs de la collectivité ne faisaient défaut, l’homme moderne s’est replié sur sa sphère d’intérêts privés. Par la même, ses relations tendent à être dominées par la logique marchande si bien que l’économie devient son unique sujet de préoccupation.
Mais, étant privé de l’appartenance communautaire naturelle de ces ancêtres, le moderne s’interroge sur son rapport à la société. Il est de fait soumis à une angoisse constante quant à sa place dans le monde d’autant plus qu’il n’a plus d’instrument politique pour modifier son destin. Se crée alors une « masse » d’individus, isolés entre eux et n’ayant aucune protection communautaire. C’est pourquoi Arendt avait parfaitement raison de souligner que cette « atomisation des masses », typique de la modernité, offre le champ libre aux Etats totalitaires pour assurer leur domination sans partage.
Le fascisme et le communisme sont donc de fait des enfants de la modernité. Toutes deux souhaitent en effet reformer cette emprise de la communauté que l’homme moderne a délaissé (8). L’objectif pour eux n’est d’ailleurs pas de revenir aux anciennes communautés mais de créer une nouvelle communauté, un nouveau stade de l’humanité dans lequel l’homme serait de nouveau subordonné aux exigences de la collectivité. Pour les communistes, cette communauté serait la société prolétarienne. Pour les Nazis, elle serait le Reich de mille ans. Dans tous les cas, cette société ne peut advenir qu’en rompant radicalement avec la société moderne ce qui fait de ces idéologies incontestablement des idéologies révolutionnaires.
(1) L’expression de Carl Schmitt
(2) Benjamin Constant, De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1814)
(3) Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1835)
(4) « L’atomisation sociale et l’individualisation extrême précédèrent les mouvements de masse qui attirèrent les gens complètement inorganisés, les individualistes acharnés qui avaient toujours refusé de reconnaître les attaches et les obligations sociales, beaucoup plus facilement et plus vite que les membres, sociables et non individualistes des partis traditionnels. » (H. Arendt, Le système totalitaire)
(5) Louis Dumont, Homo aequalis (1977)
(6) Adam Smith développe ce point dans La Théorie des sentiments moraux (1759)
(7) « Le monde moderne est, aussi, essentiellement parasite. Il ne tire sa force ou son apparence de force, que des régimes qu’il combat, des mondes qu’il a entrepris de désintégrer ». « Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne » [1914]. Charles Péguy.
(8) C’est tout le sens de l’expression de Polanyi : « Pour comprendre le Fascisme allemand, nous devons revenir à l’Angleterre de Ricardo ».
*Liste des articles de la série Fascisme et communisme :
1/20) La naissance de la modernité
2/20) La passion révolutionnaire
3/20) La haine de la bourgeoisie et antisémitisme
4/20) La première guerre mondiale
5/20) Octobre 17 et la dictature de Lénine
6/20) Bolchévisation de l’Europe et fascisme
7/20) Staline et « le socialisme dans un seul pays »
8/20) Le national-socialisme
9/20) Arendt et le système totalitaire
10/20) L’Antifascisme
11/20) La guerre d’Espagne
12/20) La seconde guerre mondiale, partie 1 : l’alliance
13/20) La seconde guerre mondiale, partie 2 : Hitler contre Staline
14/20) L’Europe de l’Est et « l’Occident kidnappé »
15/20) La mondialisation du Communisme
16/20) L’aliénation des intellectuels
17/20) La déstalinisation
18/20) Solidarnosc et dissidence
19/20) La fin du Communisme, partie 1 : évènements
20/20) La fin du Communisme, partie 2 : causes profondes





 Pour délégitimer l’ordre monarchique, il est donc nécessaire de replacer les origines de la France avant les conquêtes franques, c’est-à-dire au moment de la Gaule romaine. De là, se joue une identification dans les frontières qui jouera un rôle primordial dans la politique française de la Révolution jusqu’en 1815. Dans les esprits, la Monarchie des Bourbons s’identifie aux frontières de 1789 tandis que la Révolution s’identifie aux anciennes frontières de la Gaule, ce qu’on nomme « les frontières naturelles ».
Pour délégitimer l’ordre monarchique, il est donc nécessaire de replacer les origines de la France avant les conquêtes franques, c’est-à-dire au moment de la Gaule romaine. De là, se joue une identification dans les frontières qui jouera un rôle primordial dans la politique française de la Révolution jusqu’en 1815. Dans les esprits, la Monarchie des Bourbons s’identifie aux frontières de 1789 tandis que la Révolution s’identifie aux anciennes frontières de la Gaule, ce qu’on nomme « les frontières naturelles ».