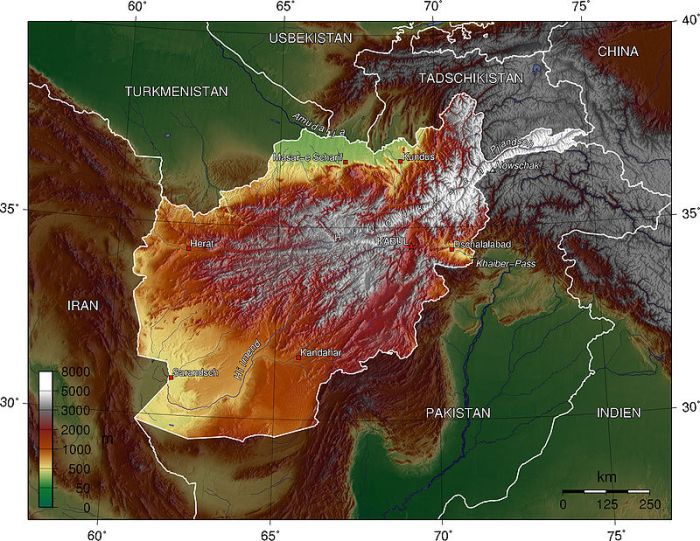« Pour la première fois depuis 70 ans, les nazis auront la parole à l’assemblée. » Sigmar Gabriel ne pouvait pas cacher sa déception à la vue des résultats. Son parti, le SPD, vient de connaître un revers quasi historique tandis que le parti AFD, placé à l’extrême-droite, avec 13% des voix parvient à faire rentrer un peu plus de 90 députés au Bundestag. Sigmar Gabriel ne fut pas le seul à s’alarmer du résultat de l’AFD, les principaux journaux allemands appelant à la résistance « face au déferlement nazi » tandis que des centaines de personnes battaient le pavé à Berlin au nom de l’antifascisme. AFD, no pasaran ! Tel le diable tapis dans l’ombre, le fascisme est une réalité sous-terraine menaçant à chaque instant de renaître de ses cendres. Comme Satan, il faut le démasquer avant qu’il ne soit trop tard.
Voilà en somme le discours affligeant diffusé en boucle dans les médias. Fait de raccourci et d’amalgame permanent entre extrême-droite, nazisme, fascisme ou même populisme, le discours médiatique occulte volontairement les vraies questions : qu’est-ce que le nazisme ? qu’est-ce que l’extrême droite ? L’AFD comme le FN sont-ils des partis fascistes voir nazis ? Ce sont ces questions qu’il faut poser sinon comment affirmer, comme le font les journalistes, que tel parti est nazi si plus personne ne sait ce qu’est le nazisme. De même, comment affirmer qu’un tel parti est d’extrême-droite si on est bien incapable que connaître l’essence politique de l’extrême-droite. Le problème réside donc dans la qualification de ces mouvements et la difficulté de les appréhender de manière intrinsèque. A cela, il faut ajouter le fait que ce discours médiatique comporte une instrumentalisation politique de l’antifascisme qu’il faudra détailler plus en détails.
Qu’est-ce que l’extrême-droite ? Voilà la vraie question
A l’extrême-droite, on associe souvent les notions de fascisme, nazisme, conservatisme, nationalisme ou populisme comme faisant partie de ces attributs. Ainsi, l’extrême-droite, quel que soit le pays, est de fait assimilée au nazisme ou au fascisme. On le voit en France ou en Allemagne où chaque poussé du FN ou de l’AFD provoque en réaction des appels à la résistance contre « le retour de la bête immonde fasciste ». D’ailleurs, Macron lui-même a joué entre les deux tours de la présidentielle sur ce raccourci FN-Nazie. Or, cette confusion entre ces termes empêche de comprendre correctement la nature des mouvements politiques d’extrême-droite.
L’erreur fondamentale de toutes les analyses politiques est de voir l’extrême-droite non pas comme un positionnement politique mais comme un corpus doctrinal claire et affirmé. En d’autres termes, il est impossible de dégager ce qui serait une essence idéologique de l’extrême-droite.
D’une part, les cultures nationales travaillent en profondeur la doctrine de ces mouvements. L’extrême-droite américaine est ainsi libérale et antibureaucratique tandis que l’extrême-droite française est avec Marine Le Pen étatique et interventionniste. Un autre exemple peut être donné avec l’Europe de l’Est, comme la Pologne, dont l’extrême-droite est culturellement plus conservatrice qu’elle ne l’est à l’Ouest du fait du rôle toujours important du catholicisme.
D’autre part, les mouvements d’extrême-droite inscrivent leur doctrine en fonction d’un contexte historique prédéterminé. Furet soulignait par exemple combien il était impossible de concevoir le fascisme et le nazisme sans prendre en compte la première guerre mondiale qui au préalable avait militarisait les sociétés rendant possible la violence totalitaire. De même, le franquisme ne saurait exister dans une Espagne en voie de sécularisation.
Qu’on y regarde de plus près, on ne saurait trouver un corps doctrinal unique à l’ensemble des partis d’extrême-droite. Il existe parfois des points communs mais ces derniers ne sauraient incarner un corpus idéologique commun. Plutôt que de parler d’une essence idéologique d’extrême-droite, il vaudrait mieux parler d’un positionnement politique même si le terme d’extrême-droite est lui-même inexacte car ces mouvements ne sont pas des droites « radicalisées » mais des partis des prenant des idées aussi bien à droite qu’à gauche. Sans doute, le problème d’identification provient de l’impossibilité de projeter ces mouvements sur un clivage gauche-droite classique.
S’il n’existe pas de doctrine commune, certains intellectuels insistent sur des pratiques communes à ces mouvements pour les définir. Ils insistent ainsi sur le culte de la violence, la culture du chef ou l’aversion pour la démocratie comme traits définissables de l’Extrême-droite. Or, forcé de constater qu’en matière de violence politique et de culte du chef, la gauche et le communisme en ont fait pendant longtemps leurs fonds de commerce. Encore aujourd’hui, la violence dans la rue est quasi exclusivement le fait de groupes d’extrêmes gauche tandis que le culte de personnalité est moins incarné en la personne de Le Pen que dans celle de Mélenchon.
Pour ce qui concerne l’aversion à la démocratie, il est quand même de mauvaise foi d’affirmer que ces partis sont anti-démocratiques alors même qu’ils participent à toutes les élections et qu’aucun d’eux ne s’est jamais affirmé, contrairement aux nazies, comme des partis anti-démocratiques. Au contraire même, ces partis sont le plus souvent des partisans de la démocratie directe et du référendum.
Ces appels au peuple font d’ailleurs l’objet du succès du terme « populisme » utilisé à tort et à travers dans les médias. C’est que beaucoup assimile extrême-droite et « populisme ». Là encore, le populisme n’est pas une idéologie définie mais un style, une manière de faire de la politique. Le populisme serait dès lors synonyme de démagogie. Mais encore une fois, l’extrême-droite n’a pas le monopole de la démagogie, la gauche l’utilisant abondamment notamment Mélenchon. De même, le discours du Bourget de Hollande est un discours populiste tant l’orateur savait très bien que ce qu’il disait était de la pure chimère.
Il est donc impossible de définir une doctrine ou une pratique d’extrême-droite englobant la totalité de ces mouvements politiques. Elle est par nature indéchiffrable selon les termes de Michel Winock* apparaissant comme « une tendance politique dure mais un concept mou ». Pourtant, cette pluralité et cette absence de définition sont largement occultées aujourd’hui et ce pour des raisons purement politiques.
L’instrumentalisation politique de l’antifascisme
On pourrait penser à première vue que la mort d’Hitler et de Mussolini avait définitivement mis fin à la menace fasciste. Or, pour les mouvements antifascistes, il n’en est rien. Pour eux, le fascisme est sans cesse une menace renaissante prête à tout moment à déferler sur la France. « Lepénisation des esprits », « bête immonde », « l’éternel retour des vieux démons », les antifascistes ne manquent pas d’expressions destinées à remobiliser l’opinion contre cette menace. Pierre-André Taguieff** affirmait justement que « nous vivons dans un univers de spectres, où aux fascismes imaginaires font écho des antifascismes imaginaires d’aujourd’hui ». Or, ce « fascisme imaginaire » crée volontairement une confusion dans les esprits rendant difficile voire impossible une bonne appréhension des mouvements d’extrême-droite.
L’antifascisme naît suite à la marche sur Rome de Mussolini en 1922. Issu des partis de gauche marxistes, l’antifascisme reste prisonnier du matérialisme historique de Karl Marx. Pour eux, le fascisme n’est que l’ultime avatar, le « stade suprême », du développement capitaliste. François Furet*** notait que « les communistes tendent à voir après coup dans les victoires du fascisme autant de « stades suprêmes » de la domination bourgeoise : « suprêmes », c’est-à-dire plus dictatoriaux que jamais, mais aussi plus fragiles et les derniers de l’histoire, porteurs sans le savoir de la révolution prolétarienne. » Or, en étant prisonnier de ce schéma marxiste, les antifascistes ne voient pas la spécificité et l’essence du fascisme. Ils le voient comme un ultra-capitalisme conservateur voire réactionnaire. Dimitrov, un des leaders du Komintern disait que « le fascisme est la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier ». Hitler serait dès lors une simple marionnette des industriels allemands.
Cette pensée, en plus d’être grotesque, occulte le caractère « révolutionnaire » de la pensée fasciste comme l’avait montré Zeev Sternhell dans La Droite révolutionnaire. Ainsi, la pensée antifasciste tend à considérer comme fasciste l’ensemble des éléments capitalistes puisque le fascisme y est supposément leurs stades ultimes. De ce simple fait, le libéralisme, le conservatisme ou la pensée réactionnaire seraient liés directement ou indirectement au fascisme. On peut dès lors comprendre pourquoi pendant la guerre froide, les communistes voyaient un fasciste dans chacun de ses opposants. De Gaulle était ainsi accusé « de coup d’état fasciste » en 1958 tandis que Raymond Aron et Hannah Arendt étaient accusés de faire le jeu du « fascisme » en osant dénoncer le totalitarisme communiste.
Caricatural sous la guerre froide, le mouvement antifasciste s’est professionnalisé à partir des années 80. La création d’associations antiracistes et communautaires et la percée du Front National aux municipales de 1984 expliquent cette transformation. La Gauche mitterrandienne dont la gauche actuelle est largement issue saura dès lors utiliser habilement l’antifascisme à des fins proprement politiques. Dorénavant, le FN sera encarté comme parti fasciste sans aucune explication. Comme le soulignait Taguieff, cet antifascisme d’opérette permet d’une part de faire oublier les crimes du communisme en se concentrant exclusivement sur « le péril brun » et d’autre part de délégitimer un adversaire politique et au-delà de ça de délégitimer certaines de ces idées.
Ainsi, il suffit que le FN soit pour le contrôle des frontières pour qu’instantanément cette idée devienne « fasciste » et donc dangereuse in fine pour la démocratie. Cette délégitimation ne s’arrête pas à l’extrême-droite puisque si la droite s’avise comme sous Sarkozy à se montrer favorable aux contrôles aux frontières, elle sera immédiatement accusée « de faire le jeu du FN », c’est-à-dire pour eux du fascisme.
Ainsi, toute idée partagée, issue ou reprise par le Front National est frappée de contamination tel un virus qu’il faut circonscrire. Dites que vous êtes eurosceptique, défavorable à l’immigration ou que vous êtes préoccupés par les effets de la globalisation, et vous serez alors contaminé par la « lepénisation des esprits », voire pire, vous serez sans le savoir « un fasciste ». Dès lors que le FN touche à une idée, cette dernière est frappée du sceau de l’excommunication et devient irrecevable dans le débat public. On peut penser par exemple à la déchéance de nationalité pour les terroristes, idée qui venant du FN faisait forcément resurgir « le spectre des années 30 ».
De fait, tout débat devient interdit sur ces questions, la politique laissant sa place à une morale humanitaire ce que Weber appelait l’éthique de conviction. Comme le dit Taguieff, « amalgamer un mouvement ou une formation politique avec « le fascisme » ou le qualifier « d’extrême droite », c’est en effet l’exclure du cercle de l’idéologiquement acceptable, c’est donc marginaliser par la diabolisation toute opposition véritable au statu quo ».
L’objectif est en tout cas clair pour la gauche, il s’agit de délégitimer certaines idées « non progressistes » en leur apposant la marque du « fascisme ». Par la même, elle pousse la droite à se désintéresser de sujets « faisant le jeu du FN » comme l’immigration, l’Europe ou l’identité si celle-ci souhaite conserver sa « respectabilité » médiatique l’affaiblissant électoralement en la coupant des préoccupations des classes populaires. Seul Sarkozy en 2007 avait osé franchir le Rubicon provoquant les réactions horrifiées de la gauche.
L’antifascisme fait donc l’objet d’une instrumentalisation politique visant à délégitimer une idée ou un adversaire politique. Le processus est simple. Il consiste d’abord à affirmer que telle idée ou parti est « d’extrême-droite » alors même qu’une essence d’extrême-droite n’existe pas. Or, si elle est « d’extrême-droite », il ne fait pas longtemps à tous les bien-pensants pour y voir le premier signe d’une résurgence du fascisme. Dès lors, l’idée ou le parti fera l’objet d’une ostracisation et d’une condamnation morale exceptionnelle. C’est pourquoi il est si important pour les antifascistes de ressusciter « l’hydre fasciste ». « Si ce péril suprême vient à manquer, nous dit Alain Finkielkraut****, ils seront comme des enfants perdus, ils tâtonneront, sans repères, dans un monde indéchiffrable. Ils sont donc aux petits soins pour la bonne vieille bête immonde de papa, pour l’ogre familier qui est devenu leur nain de jardin. C’est bien moins le fascisme qui les épouvante que l’éventualité de sa disparition. »
*Michel Winock, Histoire de l’extrême droite en France (1993)
**Pierre-André Taguieff, Du diable en politique, Réflexions sur l’antilepénisme ordinaire (2014)
***François Furet, Le passé d’une illusion (1995)
****Alain Finkielkraut, La seule exactitude (2015)